Accueil > Politique > L’identité européenne n’est pas un antidote au nationalisme
Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2023-119
 L’identité européenne n’est pas un antidote au nationalisme
L’identité européenne n’est pas un antidote au nationalisme
Par Michael Wilkinson, traduction par Jocelyne Le Boulicaut
jeudi 9 novembre 2023, par
AID soutient financièrement le très intéressant site "Les-crises.fr" depuis plusieurs années. Nous avons fait un pas de plus en participant aux traductions des textes anglais quand le site fait appel à la solidarité de ses adhérents. Nous avons donc mandaté une de nos adhérentes, Jocelyne LE BOULICAUT, enseignante universitaire d’anglais retraitée, pour y participer en notre nom et nous indemnisons son temps passé avec notre monnaie interne
L’identité européenne n’est pas un antidote au nationalisme
Le 09 Septembre 2023 par Michael Wilkinson
Michael Wilkinson est professeur de droit à la London School of Economics, il est aussi l’auteur de Authoritarian Liberalism and the Transformation of Modern Europe.
 Les drapeaux de l’Union européenne flottent devant le bâtiment de la Commission européenne à Bruxelles, le 7 décembre 2020 (Kenzo Tribouillard / AFP via Getty Images)
Les drapeaux de l’Union européenne flottent devant le bâtiment de la Commission européenne à Bruxelles, le 7 décembre 2020 (Kenzo Tribouillard / AFP via Getty Images)
Les partisans de l’Union européenne la qualifient souvent d’antidote au nationalisme. Pourtant, aujourd’hui, l’Union durcit ses frontières face au monde extérieur. Les citoyens ne parvenant pas à infléchir son orientation économique générale, l’UE est de plus en plus obsédée par son identité. Critique de l’ouvrage « Eurowhiteness : Culture, Empire et Race dans le projet européen » par Hans Kundnani (Hurst Publishers)
« Lorsque l’Allemagne a assumé la présidence semestrielle [de l’Union européenne NdT] en 2020, elle a choisi le slogan « Tous ensemble pour relancer l’Europe », raconte Hans Kundnani dans son nouveau livre, Eurowhiteness (https://www.hurstpublishers.com/book/eurowhiteness/).
« Le gouvernement allemand avait donc adopté un slogan du type de l’administration Trump (Make America Great Again) mais, parce qu’il s’appliquait désormais à une région plutôt qu’à une nation, il imaginait que cela allait le transformer en l’opposé de ce que Trump avait eu en tête ».
Les partisans de l’UE se plaisent en effet à affirmer que le bloc continental est un antidote au nationalisme. Mais Kundnani y voit autre chose : il s’agit d’un projet qui évolue vers une politique régionale fondée sur une identité civilisationnelle.
Ce régionalisme n’est pas tout à fait inédit, dans la mesure où il s’appuie sur les mythes modernes et prémodernes de l’homogénéité culturelle et de la supériorité raciale de l’Europe.
Mais il marque une rupture avec le projet citoyen de l’après-guerre, une rupture qui s’est précipitée au cours des deux dernières décennies, en particulier depuis la crise de la zone euro et l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Kundnani qualifie cette nouvelle forme politique inquiétante d’"Eurowhiteness".
Il affirme que l’euro-blancheur est encouragée non seulement par les habituels populistes de droite, mais aussi par les partis d’un centre politique qui a adopté leur rhétorique, défendant une « Europe chrétienne » ou un « mode de vie » européen face aux étrangers, qu’ils soient musulmans, russes ou originaires de pays situés aux frontières de l’Europe.
Les uns renforcent les autres : tout comme nombre de pro-européens convaincus sont prêts à travailler avec les partis d’extrême droite, de Varsovie à Rome, ceux-ci se sont également revendiqués du pro-européanisme dans leur posture identitaire face aux non-Européens.
Kundnani fait habilement éclater la bulle de ceux qui idéalisent l’UE en la présentant comme un projet cosmopolite, un projet largement gonflé par des intellectuels tels que Jürgen Habermas, même quand ils s’attaquent au déficit démocratique et à l’économie politique néolibérale de l’Union.
Le régionalisme européen s’apparente plutôt à un nationalisme « élargi », qui reproduit les pires aspects du chauvinisme national, de l’exclusion et de la rigueur des frontières, mais qui ne bénéficie pas des facteurs modérateurs d’un projet social ou des structures démocratiques nécessaires à sa réalisation.
Le contraste traditionnel entre la volonté d’ouverture de l’UE et une histoire spécifique du nationalisme (allemand), qui ne voit dans le nationalisme qu’une source de guerre et occulte son histoire émancipatrice, fait d’ailleurs partie du problème.
Développant sa critique du caractère cosmopolite de façade de l’UE, Kundnani pose un diagnostic quant à sa cause sous-jacente : la néo libéralisation de l’UE a vidé la démocratie nationale de sa substance, ne laissant dans son sillage que des simulacres de politique d’identité.
S’appuyant sur les puissantes critiques existantes concernant la légitimité démocratique de l’UE, Kundnani fait le lien entre la dépolitisation et un renouvellement des formes politiques plus inquiétantes reposant sur la culture et l’ethnicité, en un mot, qui font de la « blancheur » un facteur commun de cohésion. La promesse d’une Europe citoyenne et démocratique disparaissant, c’est l’« euro-blancheur » qui l’a remplacée.
Missions civilisatrices
De quel type de substitution s’agit-il ? Quel est le lien entre l’"Eurowhiteness" et le déficit démocratique de l’UE ? Kundnani retrace la longue et fluctuante histoire des « missions civilisatrices » européennes.
Lorsque les idéologies médiévales liées à la chrétienté ont été remplacées - progressivement et bien partiellement - par l’idéologie modernisatrice du siècle des Lumières avec ses conceptions raciales de l’Europe, qui a maintenu, et à bien des égards exagéré, les notions prémodernes d’exclusivité et de supériorité, la « blancheur » est devenue synonyme de « civilisé ».
Cette notion a servi à justifier l’expansion impériale, puis le racisme scientifique et l’eugénisme. Ce côté sombre de l’identité européenne, qui a connu un pic dans l’entre-deux-guerres, n’a jamais été totalement exorcisé.
Mais Kundnani laisse entendre que pendant la période d’après-guerre une éthique citoyenne plutôt que civilisationnelle prédominait, elle valorisait la démocratie, l’État de droit et l’économie sociale de marché.
Il estime en outre que ce courant a atteint son zénith dans la période « entre la perte des colonies européennes dans les années 1960 et le début de la crise de l’euro en 2010 ».
Avec la montée en puissance du néolibéralisme dans les années 1980 et 1990, qui s’est encore intensifiée avec le nouveau millénaire et la crise financière, cet idéal citoyen s’est affaibli, tandis que les idéologies ethnico-civilisationnelles reprenaient le dessus.
Kundnani se garde bien de rejeter entièrement les Lumières. Il ne se laisse pas non plus aller à la nostalgie de l’âge d’or de l’après-guerre. En fait, il avance que la social-démocratie a masqué plutôt que corrigé les lacunes de l’Europe en matière d’intégration.
Mais pour ce faire, il faudra effectuer un véritable travail afin de dégager les liens entre l’"Eurowhiteness" et la démocratie politique. La période de l’entre-deux-guerres en constitue le pivot fondamental. Kundnani évoque lui-même certains de ses traits saillants.
C’est à cette époque, note-t-il, que les revendications des mouvements fédéralistes pro-européens sont apparus pour la première fois. Du point de vue des grandes puissances, les différents nationalismes européens étaient devenus un obstacle à la grandeur de l’Europe, entravant son destin de gouverner le monde au nom de l’humanité.
Pour les aristocrates du mouvement paneuropéen, incarné par Richard von Coudenhove-Kalergi, le nationalisme était devenu « le fossoyeur de la civilisation européenne » et devait être éliminé.
Le sentiment europhile traduisait également l’anxiété de l’entre-deux-guerres quant au déclin de la civilisation européenne face à la puissance géopolitique croissante des États-Unis et de la Russie.
À cette époque, Carl Schmitt a théorisé l’idée d’une Mitteleuropa allemande qui serait le fruit du catholicisme et de l’anticommunisme et qui servirait d’antidote au déclin de la civilisation, un trope partagé par de nombreux membres de la droite politique.
Les contre-révolutionnaires conservateurs tels qu’Oswald Spengler , dont le Déclin de l’Occident a été publié pour la première fois en 1918, considéraient que les civilisations étaient des entités biologiques qui s’élevaient et se désintégraient naturellement.
Si l’on veut que le paneuropéisme se concrétise, il est essentiel que l’Afrique fournisse une source de matières premières et un espace physique pour permettre une exploitation coopérative par les nations européennes, plutôt que l’impérialisme compétitif qui a culminé avec la Première Guerre mondiale.
Ce projet de modernisation néo-impériale porte le nom d’"Eurafrique". Hormis les arguments du fédéralisme européen qui circulaient parmi les mouvements de résistance, vaincus ou endigués au lendemain de 1945, de telles conceptions reposaient souvent sur un sentiment de supériorité de l’Europe.
Le pan européisme en est venu à adopter une attitude plus défensive à la lumière de la reconnaissance par la guerre froide de la faiblesse géopolitique relative de l’Europe, aggravée par la décolonisation.
Pour les partis de gauche, ce concept allait devenir une profession de foi, tant pour les eurocommunistes que pour les sociaux-démocrates qui considéraient l’Europe comme la seule voie possible vers le socialisme.
Que ce soit sous la forme d’un moindre mal par rapport à l’Etat-nation, d’une eschatologie scalaire soutenue par la promesse d’une « Europe sociale » portée par le président de la Commission Jacques Delors, ou d’un élan technocratique plus général, le courant europhile a conduit la gauche dans un labyrinthe d’impasses.
À la fin du vingtième siècle, il prend des formes plus édulcorées, mais les libéraux, émerveillés par son "soft power" et son apparente stabilité politique, proclament que l’Europe est un modèle pour les nations du monde.
On retrouve des échos de ce sentiment chez ceux qui affirment que l’adhésion à l’UE est essentielle pour entretenir son influence dans le monde ou, tout au moins, pour enrayer son déclin.
Mais pour chacune de ces raisons, depuis son tout début jusqu’à aujourd’hui, « le projet européen ne se limitait pas au seul enjeu de la paix, comme les "pro-européens" de l’après-guerre l’ont souvent prétendu par la suite. Il s’est toujours agi également d’une question de pouvoir ».
Le messianisme des projets de paix est expédié sans indulgence par Kundnani, notamment en raison de la violence perpétrée par les principaux États européens après la Seconde Guerre mondiale, en particulier par la France lors de la répression brutale de l’indépendance algérienne et de la guerre d’Indochine.
Avec la fin du droit international public à « l’ère européenne », caractérisée par la nouvelle géopolitique de la guerre froide, la construction européenne au cœur de l’empire peut être comprise comme le réflexe de la décolonisation à la périphérie de l’empire.
Au fur et à mesure que la France se préoccupait du sort de ses colonies, elle se tournait vers l’intégration européenne pour tenter de maintenir son statut géopolitique.
Les colonies françaises et belges ont été intégrées au marché commun, avec toutefois des restrictions en matière de migration de la main-d’œuvre, préfigurant ainsi le programme d’élargissement à l’Est qui sera mis en œuvre plusieurs décennies plus tard.
Comme le montre Kundnani, l’Europe, indépendamment de sa propre perception et de sa rhétorique, n’a pas rompu avec sa mission « civilisatrice » de la fin du XIXe siècle. La conviction d’avoir pleinement tiré les leçons de l’histoire lui a permis de la poursuivre sous une forme modifiée.
L’Holocauste allait jouer un rôle clé, la « culture mémorielle » de l’Europe se repliant sur elle-même et sur son territoire, mettant l’accent sur les actes de cruauté commis à l’intérieur, tout en négligeant ceux commis à l’extérieur.
Le fascisme était présenté comme une souillure exceptionnelle sur une biographie par ailleurs sans tache, et non comme inexorablement enraciné dans son histoire de colonialisme, comme l’avait affirmé Hannah Arendt, ou de faire partie de la civilisation européenne, comme l’avaient laissé entendre Theodor Adorno et Max Horkheimer.
Paradoxalement, le nazisme sera également perçu comme non exceptionnel, confondu avec un totalitarisme ordinaire qui englobe l’Union soviétique de Joseph Staline. L’UE d’après-guerre est ainsi devenue, selon les termes de Kundnani, un « vecteur d’amnésie de notre empire ».
Mais il prend soin de ne pas la considérer uniquement sous cet angle. Elle a également pris la forme, selon lui, d’une "mission technocratique". Il s’agit là d’un point essentiel, qui conduit à se demander si un état d’esprit technocratique est tout simplement compatible avec une mission citoyenne démocratique.
Kundnani considère « le mode de gouvernance dépolitisé incarné par l’UE », ainsi que l’économie sociale de marché et l’État-providence de l’après-guerre, comme un élément de la gouvernance citoyenne.
Ses doutes à ce sujet se dévoilent par la suite lorsqu’il affirme que l’antidote au régionalisme ethnique est une « repolitisation de la politique économique », en vue d’inverser le tournant civilisationnel du projet européen.
En d’autres termes, une Europe démocratique se doit de redonner à la politique la place qui est la sienne, la première. Quand une telle Europe a-t-elle existé ?
Généalogie du néolibéralisme
Kundnani a certainement raison quand il présente le glissement de l’Europe vers les politiques identitaires comme une conséquence de la néo-libéralisation et en particulier de son penchant à la dépolitisation. Mais ce n’est pas un phénomène qui ne serait apparu qu’au cours des dix ou vingt dernières années.
Tout en prenant en compte la longue tradition de la « blancheur », depuis le christianisme jusqu’à l’impérialisme moderne, Eurowhiteness accorde moins d’attention à la tradition à plus long terme du néolibéralisme.
Le pan européisme est né de la volonté de préserver la position des élites dirigeantes européennes vis-à-vis non seulement du monde extérieur, mais aussi de la menace intérieure que représentaient leurs propres couches sociales dominées.
Il convient donc de mettre en évidence une autre caractéristique de l’entre-deux-guerres : la peur des élites européennes face à la démocratie de masse et à la souveraineté populaire à l’époque du suffrage universel et de la prise de conscience de la classe ouvrière.
Cette période a vu les libéraux, tout comme les conservateurs, afficher leur divorce vis à vis de la démocratie puis, à cette époque tout comme aujourd’hui, être prêts à collaborer avec l’extrême droite pour faire taire les voix dissidentes.
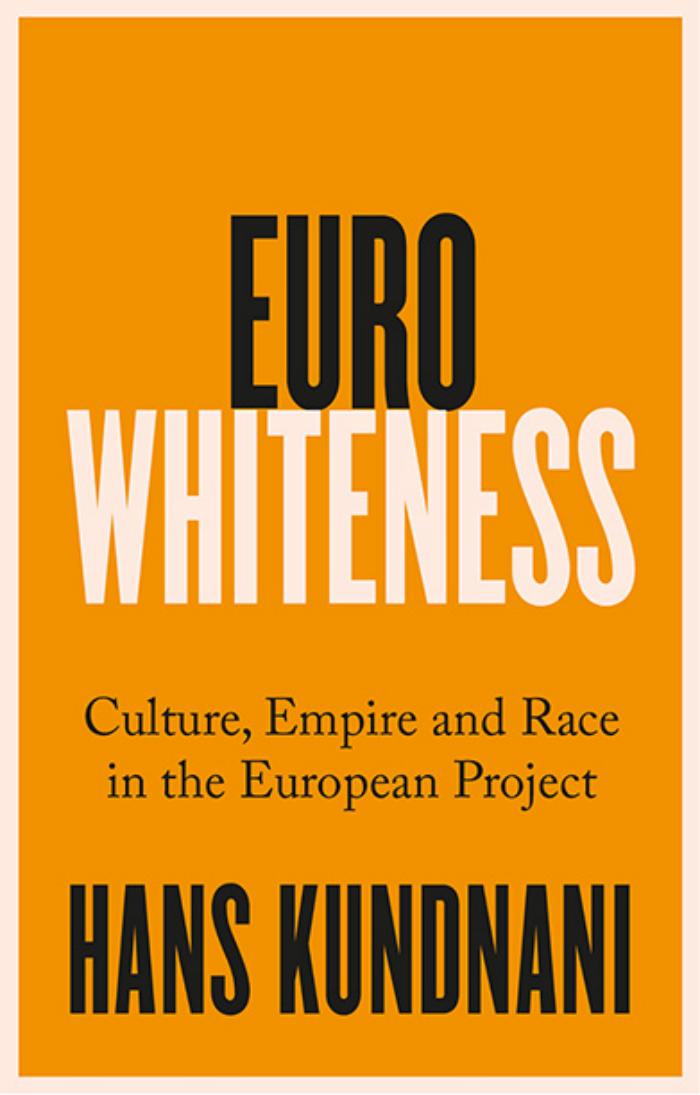 Euroblanchité : Culture, Empire et Race dans le projet européen » par Hans Kundnani
Euroblanchité : Culture, Empire et Race dans le projet européen » par Hans Kundnani
L’intégration européenne était un moyen de freiner l’élan démocratique dès le début de la construction de l’après-guerre, même si ce processus s’est étalé sur plusieurs décennies, et en tandem avec d’autres idées et institutions contre-majoritaires dans le processus d’élaboration de la constitution.
Non seulement l’UE n’a jamais été construite selon un cadre citoyen, mais en plus elle l’a été de sorte à réprimer cette composante de la vie démocratique.En Europe, dans la période d’après-guerre, la politique a consisté à maîtriser les passions politiques et à démobiliser les citoyens, conformément au libéralisme empreint de peur propre à la guerre froide.
La voie de la dépolitisation en Europe a pris différentes formes nationales. Mais l’intégration européenne a joué un rôle crucial de renforcement, appuyé par divers mythes liés à l’effondrement de l’entre-deux-guerres et par un nouvel éventail de « passions » : la foi en la fiabilité, le savoir et l’autorité de la loi et des juristes.
Cette Europe technocrate était confortée par la puissance et la technologie plus exigeantes de l’impérialisme américain. Elle se fondait sur une interprétation très biaisée de l’histoire, selon laquelle la démocratie s’était suicidée et n’avait certes pas été sacrifiée par les élites craintives du sommet de la hiérarchie.
Dans le contexte de la guerre froide, le projet européen doit être analysé non seulement dans sa dimension externe - le déclin de l’Europe à l’ère de la rivalité des superpuissances - mais aussi par rapport à sa dimension interne, à savoir la répression de puissantes forces politiques antisystème.
Dans son analyse de référence de l’intégration européenne d’après-guerre, l’historien Alan Milward identifie le point de vue du chancelier ouest-allemand Konrad Adenauer, qui considérait la Russie comme un « pays barbare non européen », à un préjugé racial largement répandu au sein du courant conservateur allemand.
Mais Adenauer était aussi farouchement anticommuniste, considérant la Russie comme une menace pour la civilisation chrétienne de l’Europe. Pendant la guerre froide, la notion d’« Occident » mêlait le civilisationnel et l’idéologique sous l’égide de la protection militaire des États-Unis et des auspices de l’OTAN, mais aussi des programmes nationaux de déradicalisation.
Selon les propos de Kundnani, la jonction entre le néolibéralisme et l’euroblanchité ne commence qu’avec la fin de la guerre froide. Le traité de Maastricht est présenté, comme dans tant d’autres ouvrages, comme un tournant.
Mais on peut aussi le considérer comme une étape. Il s’agissait d’un tournant vers un chemin qui renforçait encore la direction empruntée par l’Europe depuis les traités de Paris et de Rome.
Le néolibéralisme et les nouvelles guerres culturelles
Kundnani fait mouche lorsqu’il insiste sur la rupture brutale qui s’est produite après Maastricht. Dans les comptes rendus officiels, l’Europe était présentée comme une puissance à caractère réglementaire, axée sur les droits fondamentaux et la dignité humaine, à même de défendre la civilisation non seulement à l’intérieur de ses propres frontières poreuses, mais aussi dans le cadre de l’ensemble du champ des relations internationales.
Le modèle du cosmopolitisme ouvert était mis en avant, et les idées telles que le post-nationalisme et la post-souveraineté commençaient à régner sans partage dans les milieux académiques.La réalité politique était très différente. Avec la fin de la guerre froide, une nouvelle mouture du régionalisme s’est imposée.
L’Europe à laquelle les pays d’Europe centrale et orientale allaient adhérer se démarquait alors du libéralisme enraciné de sa phase fondatrice. Dans les années 1990, le néolibéralisme était hégémonique et le marché unique était devenu un cheval de Troie qui déstabiliserait les régimes nationaux de protection sociale et de négociation collective.
Les spécialistes de l’UE, et en particulier les juristes, connaissent parfaitement ce scénario, en raison du rôle particulier que la Cour de justice européenne a joué pour libéraliser le marché en favorisant la libre circulation des moyens de production.
Conjointement avec l’Union économique et monétaire (UEM), l’UE de la période post-Maastricht devait permettre de déchirer le contrat social d’après-guerre entre le travail et le capital.
Mais tout en visant à l’homogénéisation du modèle économique anglo-saxon, elle allait contribuer à accroître les clivages au sein de l’UE, entre les différents rythmes de croissance, et au niveau régional entre le nord et le sud, l’est et l’ouest.
Tout au long de la récente décennie de « polycrises » , une Europe plus défensive, déstabilisée et angoissée est apparue. L’UE n’était plus un modèle pour les nations du monde, mais un organisme luttant pour contrer toute une série de crises qui, à certains moments, semblaient devenir existentielles.
On l’a reconnue comme étant une concurrente dans une course mondiale, où elle semblait avoir des résultats plutôt médiocres. La crise de l’euro a marqué le début d’une période où il fallait « couler ou nager ».
Pour la chancelière Angela Merkel, soutenue par un bloc de pays fidèles au modèle économique allemand, la crise de l’euro était synonyme d’austérité et du refus de toute forme d’aléa moral, ce qui a eu pour effet de réduire à néant les derniers vestiges de la solidarité internationale.
Pour satisfaire aux exigences du programme d’Emmanuel Macron, le projet a ensuite été reformulé pour devenir une « Europe qui protège ». Mais dans les deux cas, cela voulait dire une UE plus hiérarchisée et plus coercitive, alors même que son adhésion rigide au libéralisme de marché était suspendue par la pandémie.
Il s’agissait également d’une Europe dont les frontières méridionales devenaient de plus en plus étanches, avec des conséquences tragiques. Pour Kundnani, cette décennie a été marquée par le fait que la « blancheur » elle-même est devenue plus centrale dans le projet européen.
 Le président de la Confédération allemande des syndicats, Ernst Breit (G), le président de la Commission européenne, Jacques Delors (C), et le président des employeurs, Klaus Murmann (D), lors d’une conférence de la Communauté européenne, en 1988 à Cologne (Wilhelm Leuschner / picture alliance via Getty Images)
Le président de la Confédération allemande des syndicats, Ernst Breit (G), le président de la Commission européenne, Jacques Delors (C), et le président des employeurs, Klaus Murmann (D), lors d’une conférence de la Communauté européenne, en 1988 à Cologne (Wilhelm Leuschner / picture alliance via Getty Images)
Les élites européennes, bien que contestant rhétoriquement la poussée de l’extrême droite sur le continent, ont adopté son cadre de pensée en termes de civilisation et de concurrence.
Le parti Fidesz de Viktor Orbán a continué à siéger au sein du Parti populaire européen au Parlement européen bien longtemps après des années de condamnations véhémentes (il l’a finalement quitté en 2021), et son euroscepticisme de façade a fait des émules dans des formations de droite en Pologne et en Italie.
Le libéralisme centriste et la droite ont donné une image de leur opposition mutuelle alors qu’ils étaient enlacés dans un tango bien orchestré. Un euroscepticisme feutré a également vu le jour du côté des populistes de gauche, tout aussi apparemment de surface mais beaucoup moins efficace pour diriger le mouvement, dans la mesure où la chorégraphie favorisait leurs opposants à chaque pas.
L’incertitude grandissante engendrée par le vote du Royaume-Uni en faveur de la sortie de l’UE, l’ébranlement de l’ordre international libéral par Donald Trump et la menace russe croissante ont provoqué un retour à la rhétorique de l’entre-deux-guerres, selon laquelle l’Europe doit exprimer sa propre identité géopolitique et poursuivre son autonomie stratégique, voire sa propre « souveraineté ».
Ce concept, porté par Macron, n’est pas parvenu à émouvoir Merkel et d’autres. Déçu par l’absence de mouvement centralisateur dans la zone euro et les affaires étrangères de l’UE et confronté à des batailles turbulentes dans sa tentative de néolibéraliser son économie nationale, Macron s’est tourné vers une guerre culturelle de son cru, dans laquelle il s’agissait de défendre la République française contre l’islam. « La contestation politique s’est déplacée pour passer des enjeux économiques aux questions culturelles », note Kundnani, « l’extrême droite s’est renforcée ».
L’économie politique de l’euro-blancheur
Le sous-titre de l’ouvrage Eurowhiteness est Culture, Empire and Race in the European Project (Culture, Empire et Race dans le projet européen). Le rôle joué par la race, voire par la « blancheur » elle-même, dans l’élaboration de la forme politique de l’Europe, est manifestement absent ; le terme fonctionne plutôt comme une sorte de signifiant négatif.
Il ne s’agit pas d’une donnée constante dans les affaires européennes, mais elle n’est pas non plus entièrement marginale. Le terme entretient une certaine relation de cause à effet avec le néolibéralisme, mais cette relation reste vague dans ses grandes lignes.
L’étiquette "Eurowhiteness" pourrait indiquer qu’il existe une opposition avec une « blancheur » différente qui ne serait pas européenne - une blancheur transatlantique peut-être - mais ce n’est pas le cas. Il n’y a pas non plus de différences dans le concept de blancheur sur l’ensemble du continent.
Il est important de rappeler que le terme d’Eurowhiteness a été initialement inventé par le sociologue hongrois József Böröcz pour mettre en évidence une hiérarchie de la blancheur en Europe, pour opposer la blancheur de l’Europe occidentale ou septentrionale à la « blancheur sale » de l’Europe centrale et orientale.
Le discours sur la race blanche lui-même, comme le note également Kundnani, est né de la tentative de diviser la classe ouvrière dans les États-Unis de la période Antebellum [Dans l’histoire des États-Unis le nom Antebellum est souvent utilisé (et plus spécialement dans le Sud américain) pour faire référence à la période de la montée du séparatisme conduisant à la guerre de Sécession, NdT].
Dans l’idiome marxiste traditionnel, il fonctionne comme une idéologie superstructurelle, représentant mais aussi déformant la réalité matérielle sous-jacente de l’exploitation du travail et du conflit de classe.
Mais même si Kundnani note que les origines de l’exloitation de la blancheur sont à chercher dans une stratégie de la classe dirigeante consistant à creuser un fossé entre les classes dominées et à entraver leur sens de la solidarité, la notion de classe n’apparaît pas dans son livre.
Tout au long de la crise de l’euro, le mouvement politique grec dénonçant le régime d’austérité de l’UE a été microgéré et de fait détruit, même si il s’est en grande partie autodétruit. Dans le même temps, le centre et la droite ont uni leurs forces, combinant néolibéralisme et culturalisme, exactement comme le soutient Kundnani.
Eurowhiteness élude cependant en grande partie la question de l’économie politique du système hiérarchique qui a pénétré l’UE depuis la réunification allemande et l’introduction de la monnaie unique.
La question du néocolonialisme interne qui a émergé de la crise de l’euro, exacerbant les clivages entre débiteurs et créanciers, ainsi qu’entre le nord et le sud, l’est et l’ouest, est soulevée, mais les répercussions sur la politique intérieure ne sont pas totalement prises en compte dans l’analyse. C’est surprenant dans la mesure où la question de la semi-hégémonie allemande est une question qui a été largement abordée par Kundnani dans d’autres ouvrages.
L’euro-blancheur reste donc du domaine de l’idéologie, ou du discours, utilisé par ceux qui prônent un régionalisme européen sur la base de l’ethnicité ou de la religion, mais aussi par Kundnani lorsqu’il critique l’hypocrisie des élites européennes, et qu’il veut déboulonner le mythe de l’Europe cosmopolite. Invoquer l’« Eurowhiteness » dans ce second sens revient à jeter un regard sceptique sur le projet.
Mais cette vision est renforcée par la position optimiste de Kundnani qui affirme qu’en quittant l’UE, le Royaume-Uni a, au moins en ce qui le concerne, une chance de devenir moins « blanc ». Au-delà des slogans creux de « Global Britain » avancés par certains Brexiters ; qu’est-ce que cela signifie réellement ?
Pour Kundnani, cela représente la possibilité d’un rééquilibrage, non seulement en termes de remboursement de la dette historique envers le Commonwealth et d’encouragement de l’immigration extra-européenne, mais aussi en termes de repolitisation de la société.
Le raisonnement théorique est ici plutôt implicite. Kundnani oppose un régionalisme ethnique à un régionalisme démocratique. Cette distinction fonctionne par le biais d’un contraste entre un ethos civilisateur illibéral et un ethos citoyen libéral.
Mais il existe également un ethos de type civico-républicain, qui donne la priorité au citoyen en tant qu’animal politique, ou dans un schéma représentatif, qui donne la priorité aux partis politiques en tant que médiateurs entre l’Etat et la société.
Un régionalisme civique de type républicain est-il vraiment possible ? Les diverses tentatives avortées pour créer un « demos » européen ou même tout simplement pour résoudre le déficit démocratique de l’UE laissent penser qu’il s’agit d’une tâche ardue.
Mais pourquoi la sortie d’un bloc régional rendrait-elle plus probable la possibilité d’une vie citoyenne dynamique ? Pourquoi ne pas revenir à un nationalisme ethnique « en petit » ?
La démocratie comme antidote à l’euroblanchité
La réponse - qui a échappé à certains commentateurs de l’ouvrage - réside dans la démocratie et la politique, et elle exige que l’on explique comment la conception de l’Europe au cours des périodes de l’entre-deux-guerres et de l’après-guerre les ont réprimées. Kundnani montre que le régionalisme ethnique est inversement lié à la politisation.
Il n’est pas vrai que si l’UE fonctionnait comme elle est censée le faire, elle serait un paradis cosmopolite ; que sans l’hypocrisie de ses élites, ses déficiences seraient surmontées. Elle fonctionne précisément comme elle est censée le faire, avec bien sûr des pépins involontaires, petits et grands.
Kundnani rejette l’idée selon laquelle le Brexit doit être considéré sous l’angle soit culturel soit économique, ou même sous l’angle d’une combinaison des deux. En réalité, affirme-t-il, les questions politiques ont dominé ; le Brexit était fondamentalement une question de démocratie et de souveraineté populaire.
Les inquiétudes concernant la souveraineté indiquent moins le « réflexe autoritaire », que d’aucuns ont vu dans le Brexit au travers du prisme du « populisme », qu’un « réflexe démocratique » et en particulier « le sentiment que la démocratie avait été vidée de sa substance ».
Pour tout du moins certains citoyens britanniques, le Brexit n’était pas tant l’expression d’une colère blanche que l’inverse : le rejet d’un bloc lui-même perçu comme raciste. Kundnani ne présente pas le Brexit comme une panacée ; il pourrait bien être une condition nécessaire mais loin d’être suffisante pour restaurer un nationalisme civique.
Mais il met peut-être en évidence ce qui est indispensable : un universalisme différent, transnational et repolitisé, qui s’oppose à l’UE et nécessite très probablement une rupture avec celle-ci.
Dans son analyse désormais incontournable de l’eurocentrism , le marxiste égyptien Samir Amin explique que les classes dirigeantes périphériques sont tributaires du système impérialiste parce parce que ce dernier reproduit les conditions concrètes qui leur permettent d’occuper une position de pouvoir vis-à-vis de leurs propres populations.
Amin prend bien soin de ne pas simplement substituer à l’eurocentrisme une image inversée du monde qui donnerait la priorité aux non-Européens, mais il analyse l’eurocentrisme comme une forme de « culturalisme ». Il s’agit d’éviter de sombrer dans le relativisme et l’esprit de clocher, et de plaider pour un « universalisme universel » plus abouti, comme le fait Kundnani.
Pour Amin, il s’agit d’appeler à se libérer du système capitaliste mondial. Pour s’y retrouver dans cet ensemble complexe, il développe le concept d’une « seconde modernité », autrement dit la modernité de Marx et la démocratie radicale, par opposition à la version bourgeoise qui promettait la liberté pour tous, mais ne la rendait possible qu’à quelques-uns.
Cela permet de mettre en évidence un point essentiel. La racialisation elle-même est une voie vers la dépolitisation. L’antidote à l’euro-blancheur est une dialectique politique dans laquelle les différences - de classe, de race, de sexe - peuvent être abordées, soumises à débats et décidées démocratiquement.
Si, dans une large mesure, l’UE fonctionne exactement comme elle est censée le faire, le problème n’est pas tant la blancheur de l’Europe que son européanité : une combinaison d’idées et d’institutions qui sert à limiter la démocratie d’une manière de plus en plus autoritaire.
Version imprimable :
 AID Association Initiatives Dionysiennes
AID Association Initiatives Dionysiennes